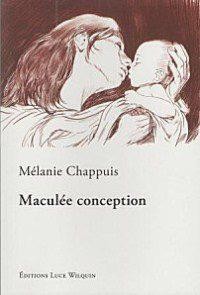Quand et pourquoi avez-vous décidé que l’écriture tiendrait une place prépondérante dans votre vie?
Quand et pourquoi avez-vous décidé que l’écriture tiendrait une place prépondérante dans votre vie?
JMO — J’ai commencé par la musique et par la poésie. Puis, insensiblement, vers 15-16 ans, les deux se sont fondues au point de ne faire plus qu’une. Il n’y a pas de décision làdedans. L’écriture s’est imposée comme une planche de salut. Une tour de guet pour observer le monde et le comprendre.
IA — C’est venu graduellement. J’ai toujours écrit, mais je m’éparpillais dans plusieurs formes d’art. Vers 25 ans, je me suis dit que ce serait bien d’en choisir une et de l’approfondir. L’écriture était celui qui comblait le plus mon besoin de m’exprimer. Cela me procure un plaisir sans pareil. Je ne peux plus m’en passer. Si je n’écris pas, je ressens un vide en moi.
Qu’est-ce que ce choix a impliqué et implique dans votre vie?
JMO — Écrire, pour moi, c’est la règle des trois S: solitude, silence, secret. On écrit toujours seul, dans le silence et le secret à révéler. Cela n’implique pas une vie solitaire. Mais un espace de solitude et de silence. Un jardin secret. Ce jardin, pour moi, est ouvert au monde. Il a un nom: c’est le roman. Un lieu qui engloberait toutes les disciplines: la musique, la peinture, la philosophie, la psychanalyse... Ce que Joyce a fait dans Ulysse, par exemple. Un roman total.
IA — Comme toutes mamans qui travaillent à temps partiel, cela implique de l’organisation et de la discipline envers soi-même.  J’ai dû trouver un équilibre entre le travail, ma famille, mes amis et l’écriture. Lorsqu’on pratique un sport de haut niveau, c’est plus reconnu. Mais manquer un événement ou se priver de quelque chose «pour écrire», cela fait sourire. Je ne prétends à aucune mission. Mais un romancier apporte un regard personnel sur la société d’une époque. Il soulève des questions, provoque des réactions.
J’ai dû trouver un équilibre entre le travail, ma famille, mes amis et l’écriture. Lorsqu’on pratique un sport de haut niveau, c’est plus reconnu. Mais manquer un événement ou se priver de quelque chose «pour écrire», cela fait sourire. Je ne prétends à aucune mission. Mais un romancier apporte un regard personnel sur la société d’une époque. Il soulève des questions, provoque des réactions.
Quel statut ont les écrivains dans notre pays en particulier et le monde en général ?
JMO — En Suisse, les écrivains ont peu de place, hélas. Certains sont largement subventionnés, d’autres ne reçoivent jamais un sou. Mais cela ne leur confère aucun statut social. D’une manière générale, ils ont beaucoup de peine à faire entendre leur voix. En France ou en Allemagne, les écrivains ont souvent une tribune dans les journaux ou les hebdomadaires, alors qu’en Suisse, on leur donne rarement la parole. On a peur de leur voix.
IA — Je ne fréquente pas le milieu littéraire dans mon quotidien. Mais il me semble que les écrivains sont discrets. Et je constate qu’être écrivain est une activité que l’on pratique à côté d’un «premier métier»...
Écrire en Suisse, qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
JMO — Pour reprendre le titre d’une émission de télévision célèbre, chaque écrivain a des racines et des ailes. Je ne crois pas aux écrivains hors sol. Où qu’on aille, un peu de terre natale reste toujours collé à nos semelles. Ce n’est pas un poids ou une limitation. Regardez encore Joyce: il porte son Irlande natale en lui et c’est à partir de cet héritage qu’il écrit. Pour mieux s’envoler. Aller à la rencontre du monde et des autres.
IA — Cela implique de garder les pieds sur terre et rester modeste. La scène littéraire est assez discrète en Suisse, peu mise en avant. Notre succès garde des proportions à l’échelle romande. L’immense avantage en revanche, est qu’au niveau régional, les gens nous soutiennent. Je suis jurassienne, je vis dans le canton de Vaud depuis 8 ans, et les deux cantons m’ont soutenue lors de mon entrée en littérature.
Que peut, et doit, transmettre un écrivain à un autre écrivain?
JMO — Ce n’est pas à l’école qu’on apprend à écrire. C’est en lisant, encore et toujours, les livres des autres. En dévorant les bibliothèques. En écumant les librairies. Je crois que la transmission se fait surtout par la lecture. Une sorte de «transsubstantiation». Mais fréquenter des écrivains (ou des artistes en général) est extrêmement précieux. J’ai eu la chance de fréquenter de grands écrivains comme Aragon, Chessex, Quignard, Starobinski, Derrida. Ils m’ont beaucoup encouragé, non pas par leurs conseils, mais par leur amitié et leur écoute.
IA — Le processus de création est un acte bien mystérieux et chaque écrivain a quelque chose de différent à transmettre. Tout est intéressant! Ceci dit, écrire reste une activité solitaire et un dialogue avec soi-même.
Peut-on apprendre à écrire?
 JMO — Je n’ai jamais appris à écrire. C’est la vie, ses bonheurs et ses drames, et la langue dans laquelle je suis né qui forgent mon écriture. J’écris avec mon corps et mes émotions. J’invente une voix dans la langue. Ce qui me pousse en avant? Le désir de vivre d’autres vies, sans doute. De voyager grâce aux livres des autres et d’élargir mon horizon.
JMO — Je n’ai jamais appris à écrire. C’est la vie, ses bonheurs et ses drames, et la langue dans laquelle je suis né qui forgent mon écriture. J’écris avec mon corps et mes émotions. J’invente une voix dans la langue. Ce qui me pousse en avant? Le désir de vivre d’autres vies, sans doute. De voyager grâce aux livres des autres et d’élargir mon horizon.
IA — Du moment que les idées sont là, bien sûr que l’on peut apprendre à écrire. D’ailleurs en Amérique, il y a des écoles d’écrivains. C’est avant tout du travail. De mon côté, je lis énormément en essayant d’analyser ce que je lis, de comprendre comment l’auteur a construit son texte. C’est la meilleure école. Ensuite je remanie mes phrases des dizaines de fois jusqu’à ce que mon texte et son rythme me conviennent.
Que vous amènent les discussions et le compagnonnage avec votre poulain/avec votre parrain? Qu’appréciezvous chez lui ?
JMO — Je trouve extrêmement stimulante la rencontre avec un autre écrivain. Le dialogue, l’échange, le partage d’expériences a priori très différentes (le parrain est rodé au milieu littéraire, tandis que le poulain - ou la pouliche! - n’en connaît pas encore les ficelles). J’aime la fraîcheur de mes conversations avec Isabelle, comme j’ai aimé le rythme et la vivacité de son livre, «Un été de trop». J’aime surtout
l’espérance de ce qui va suivre: le livre à venir. Celui qu’on rêve. Le livre qui n’existe pas encore.
IA — J’éprouve un énorme plaisir à parler littérature pendant des heures, de pouvoir poser toutes les questions que j’ai toujours eu envie de poser à un auteur aussi reconnu que Jean-Michel. Il fait preuve d’une grande humilité. Peut-être parce qu’il enseigne à des jeunes qui n’ont aucune idée de la chance qu’ils ont! Par son métier, il a une perception pédagogique de l’écriture. Il essaie d’intéresser les
jeunes à son art, de leur démontrer la puissance des mots. C’est magnifique. Concernant son style d’écriture, il ne choisit pas la voie de la facilité. Il veut progresser, explorer de nouveaux horizons. Lorsqu’une recette fonctionne, au lieu de resservir le même plat, il en essaie une autre. Il se met en danger à chaque fois. C’est une leçon: ne pas se reposer sur ses acquis. Mais cela pourrait aussi être: ne te sens jamais enfermée dans un carcan. Jean-Michel est avant tout un père et j’aime sentir que même à son niveau, ce qui nous rattache à la réalité est notre famille. S’il était un célibataire endurci qui s’était consacré à l’écriture, il y aurait un gouffre entre nous. Alors que là, il devient un modèle.
Concilier famille et écriture est possible. Et c’est même ce qui nous nourrit. Elle est notre énergie, essentielle à notre équilibre. ■
*En réponse à des questions d'Isabelle Falconnier.
Photo © Thomas Zoller
 Dans son dernier livre, Jon Ferguson, peintre, écrivain et coach de basket (il a entraîné à peu près tous les clubs de Suisse romande) prend le problème à rebrousse-poil. Et si la vraie libération, justement, passait par la prison ? Et si, pour devenir enfin celui qu’on pressent être, il fallait lâcher prise, comme on dit, se réfugier dans le silence et se faire interner ?
Dans son dernier livre, Jon Ferguson, peintre, écrivain et coach de basket (il a entraîné à peu près tous les clubs de Suisse romande) prend le problème à rebrousse-poil. Et si la vraie libération, justement, passait par la prison ? Et si, pour devenir enfin celui qu’on pressent être, il fallait lâcher prise, comme on dit, se réfugier dans le silence et se faire interner ? Au contraire, médecins et infirmières sont aux petits soins. Il mange à heure régulière. Il fait de longues promenades dans le parc. Il reçoit de temps à autre la visite de sa première épouse. Sa seconde femme, Glenda, vient également le visiter, avec sa petite fille, Gloria. Elles se doutent de quelque chose. Mais quoi ? Foster est-il vraiment fou ou joue-t-il la comédie de la folie ? Et pourquoi garde-t-il le silence ?
Au contraire, médecins et infirmières sont aux petits soins. Il mange à heure régulière. Il fait de longues promenades dans le parc. Il reçoit de temps à autre la visite de sa première épouse. Sa seconde femme, Glenda, vient également le visiter, avec sa petite fille, Gloria. Elles se doutent de quelque chose. Mais quoi ? Foster est-il vraiment fou ou joue-t-il la comédie de la folie ? Et pourquoi garde-t-il le silence ? On reconnaît, ici, les interrogations du philosophe. Car Ferguson, en grand sportif, est féru de philosophie — Nietzsche en particulier, auquel il a consacré un petit livre**. Et le serpent qui provoque la crise de Foster ressemble au cheval maltraité qui plongea Nietzsche dans la démence, un certain jour de janvier 1889, à Turin. À partir de ce jour, le philosophe allemand ne prononça plus un mot, se contentant de jouer et chanter de la musique.
On reconnaît, ici, les interrogations du philosophe. Car Ferguson, en grand sportif, est féru de philosophie — Nietzsche en particulier, auquel il a consacré un petit livre**. Et le serpent qui provoque la crise de Foster ressemble au cheval maltraité qui plongea Nietzsche dans la démence, un certain jour de janvier 1889, à Turin. À partir de ce jour, le philosophe allemand ne prononça plus un mot, se contentant de jouer et chanter de la musique.